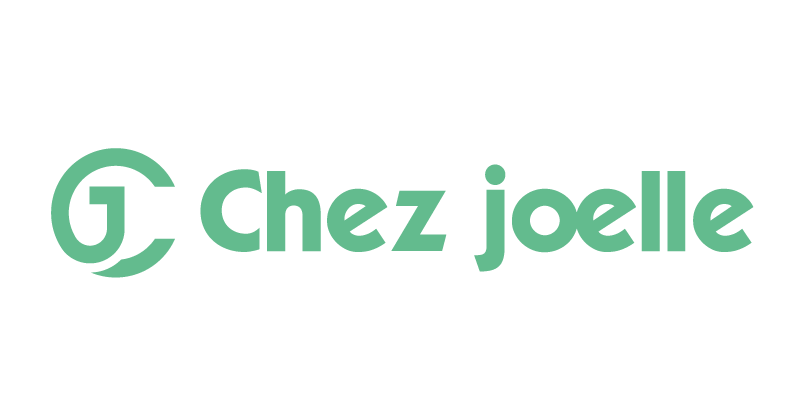Un chiffre, une règle, et des milliers d’agents publics qui la vivent au quotidien : depuis 2018, un agent public en arrêt maladie voit sa rémunération suspendue le premier jour d’absence, sauf exceptions médicales précises. Cette mesure, abrogée puis rétablie à plusieurs reprises, alimente encore débats et incompréhensions au sein des administrations.
La règle ne s’applique pas aux congés pour longue maladie ni en cas d’accident de service. Son fonctionnement diffère de celui observé dans le secteur privé, où le délai de carence et la prise en charge par l’Assurance maladie obéissent à d’autres modalités.
Comprendre la journée de carence dans la fonction publique : origine et définition
La journée de carence traduit concrètement la suspension de rémunération pour le premier jour d’un arrêt maladie chez les agents publics. Apparue en 2012 sous le gouvernement Fillon, elle disparaît en 2014 avant de revenir en force dès 2018. À l’origine : l’idée de limiter les arrêts courts, jugés parfois abusifs, et d’inciter à plus de responsabilité. La fonction publique s’aligne ainsi sur une pratique déjà installée dans le secteur privé, même si chaque univers conserve ses propres codes.
Le principe, dans le détail, s’étend à tout agent soumis au droit public, qu’il soit titulaire ou contractuel. Lorsqu’un arrêt maladie ordinaire est prescrit, le salaire du premier jour n’est pas versé. Mais attention, cette règle ne s’applique pas aux congés pour longue maladie, ni aux accidents de service ou aux maladies professionnelles : ces situations relèvent d’une logique protectrice différente.
En France, le mot carence arrêt maladie a le don de susciter la controverse. Les syndicats dénoncent une mesure financièrement pénalisante, qui touche d’abord les agents les plus fragiles, sans effet prouvé sur l’absentéisme. Les partisans de la carence avancent de leur côté l’argument de l’équité entre fonction publique agents et salariés du privé.
Le sujet ne cesse d’alimenter les discussions. La journée de carence questionne le sens même de la protection sociale dans la publique et le fragile équilibre entre responsabilisation et solidarité. Son rétablissement s’inscrit dans une dynamique plus large, où la gestion des agents publics et la rationalisation des finances publiques sont en permanence scrutées et réformées.
Quels fonctionnaires sont concernés et dans quelles situations s’applique la retenue ?
La journée de carence concerne l’ensemble des agents publics de la fonction publique : fonctionnaires titulaires, contractuels, agents des trois versants, État, hospitalier, territorial. Dès lors qu’on dépend du droit public, la retenue s’impose en cas de congé maladie ordinaire.
Ce dispositif se déclenche pour un arrêt maladie de courte durée. À partir du premier jour d’absence, la rémunération s’interrompt. Il existe cependant des situations où cette règle ne s’applique pas.
Voici les principaux cas d’exclusion :
- Maladie professionnelle ou accident de service : la carence ne s’applique pas.
- Congé de longue maladie, de longue durée ou congé pour invalidité temporaire imputable au service : également exclus.
- Femmes enceintes arrêtées suite à leur grossesse : aucune retenue ne s’applique.
En dehors de ces circonstances, la carence arrêt vise spécifiquement les arrêts pour maladie ordinaire. Même lors d’arrêts successifs, le délai de carence s’applique, sauf si la reprise entre deux arrêts n’excède pas quarante-huit heures : dans ce cas, une seule retenue s’effectue.
Prenons un exemple : qu’il s’agisse d’un agent hospitalier, d’un enseignant ou d’un employé de collectivité territoriale, tous se voient appliquer la même règle pour le congé maladie ordinaire. Derrière cette apparente uniformité, les questions sur l’équité de la protection sociale dans le secteur public restent vives.
Les évolutions législatives récentes autour des arrêts maladie
La journée de carence n’a rien d’immuable. Depuis son introduction en 2012, la réglementation n’a cessé de bouger, au gré des crises sanitaires, des contraintes budgétaires et des revendications syndicales. Les agents de la fonction publique ont ainsi vu la règle disparaître, réapparaître, puis s’adapter selon les priorités politiques et sanitaires.
En 2014, la loi supprime la carence arrêt maladie dans la fonction publique, mais la mesure revient dès 2018. Puis, la crise du covid-19 impose une parenthèse : la retenue est suspendue pour les agents déclarés « cas contact » ou positifs, afin de protéger la collectivité. Cette dérogation, pilotée par Bercy, s’achève en février 2023, marquant le retour à la règle classique.
Depuis cette date, le délai de carence s’applique à tous, y compris dans la fonction publique territoriale et les collectivités territoriales. Les discussions parlementaires ont remis sur la table certaines attentes persistantes : élargissement des exonérations, harmonisation des droits entre les trois versants du service public, articulation avec la protection sociale complémentaire en cours de mise en place. Ce dossier reste mouvant, étroitement suivi par les syndicats et les associations d’élus.
Autre sujet d’actualité : les lignes directrices de gestion et leur influence sur la gestion des absences pour arrêt maladie. Les collectivités s’interrogent sur leurs marges de manœuvre, tandis que le législateur s’attache à préciser le cadre dans la continuité du droit public.
Fonction publique et secteur privé : des différences notables à connaître
La journée de carence marque une distinction claire entre deux univers : la fonction publique d’un côté, le secteur privé de l’autre. Tous deux imposent un délai de carence en cas d’arrêt maladie, mais la façon dont il s’applique diffère sensiblement.
Dans le secteur privé, la règle générale prévoit trois jours de carence non indemnisés pour chaque nouvel arrêt maladie, sauf si un accord collectif prévoit mieux. Dans le public, la retenue concerne une seule journée, appliquée à chaque arrêt pour maladie ordinaire, sans distinction de statut entre les différentes branches de la fonction publique. Cet écart, minime en apparence, a un impact réel sur le revenu.
Pour aider à y voir plus clair, comparons les deux régimes :
- Secteur privé : 3 jours non rémunérés, sauf exceptions prévues par l’employeur ou la convention collective.
- Secteur public : 1 jour de carence, généralisé à tous les agents, hors maladie professionnelle ou accident de service.
Autre point commun entre privé et public : lorsqu’il s’agit de maladie professionnelle ou d’accident du travail, aucune carence n’est appliquée. La protection sociale intervient alors dès le premier jour, preuve qu’un consensus existe pour couvrir pleinement les risques professionnels.
Régulièrement, la question de l’équité entre ces deux mondes ressurgit dans le débat public. Entre impératifs budgétaires et volonté d’assurer l’égalité entre salariés et fonctionnaires, la comparaison reste vive. Le Conseil d’État, régulièrement sollicité, veille à la conformité du dispositif avec le droit public et les grands principes d’égalité.
Suspendue, réinstaurée, adaptée : la journée de carence dans la fonction publique reste un marqueur de notre rapport collectif à la solidarité et à la responsabilité. Derrière chaque jour non payé, il y a des questions de justice, d’efficacité, mais aussi de confiance envers celles et ceux qui font vivre les services publics. Le débat, lui, n’a pas dit son dernier mot.